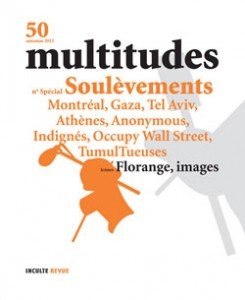Pratiques sociales et de lutte du mouvement No Tav
Nous sommes en Val de Suse, une vallée alpine très étendue à l’ouest de Turin, l’une des voies principales entre l’Italie et la France. Depuis la fin des années quatre-vingt-dix, ici on résiste contre la construction de la ligne ferroviaire à grande vitesse du corridor européen no5 qui devrait relier l’Ukraine au Portugal, en une petite partie financée par l’Union européenne Jusqu’ici avec succès, grâce à la résistance organisée en 2005. Jusqu’à ce jour les travaux n’ont pas encore commencé, on a seulement borné le terrain nécessaire à la galerie d’exploration pour la réalisation du tunnel entre l’Italie et la France. Le mouvement a rencontré l’opposition de tous les partis italiens, et surtout du centre gauche ; le projet a le soutien du nouveau président français Hollande.
Les effets du TGV sur l’environnement et la santé suscitent des inquiétudes, à cause des quinze ans de travaux prévus, de la bétonnisation accrue du territoire et de différents types de pollution (la libération d’amiante et d’uranium contenus dans les roches à creuser pour la réalisation du tunnel). Ceci dans une vallée déjà traversée par deux routes à fort trafic, une autoroute, une ligne à haute tension et une ligne ferroviaire. Mais ce serait une erreur de ne voir dans cette lutte qu’une simple réédition du mouvement environnementaliste. En effet, le discours No Tav s’est élargi à la défense du territoire, et à la contestation du modèle de développement global qui préside aux « grands travaux ». Le principal intérêt de la réalisation du TAV ne consiste pas dans l’augmentation des flux futurs de trafic entre Turin et Lyon, qui sont déjà aujourd’hui en forte décroissance selon un trend estimé irréversible, mais dans la possibilité de profit inhérente aux travaux de construction dans lesquels l’investissement est financé par l’État et les profits sont privatisés. Ceci s’accompagne de l’évidente absurdité du projet : même en acceptant les données officielles sur le volume futur de trafic passager et de marchandises, les capacités d’offre correspondantes seraient plus rapidement et économiquement réalisables en modernisant la ligne existante actuellement utilisée seulement à 30 %.
Dans le courant de l’été 2011 le conflit s’est exacerbé : après un nouvel ultimatum, de l’Union européenne, fin juin, il y a une véritable action d’occupation militaire de la zone de Chiomonte là où devraient démarrer les travaux. Le campement qui avait été construit par le mouvement et dénommé République libre de la Magdalena a été évacué brutalement. Il s’en est suivi un grand mouvement de masse à partir du 3 Juillet, avec la présence de plus de 50 000 personnes, des résidents de la vallée, des activistes italiens et étrangers. Les affrontements avec les militaires et la police ont duré toute la journée. La mobilisation a continué les mois suivants avec les initiatives du mouvement et en réponse au décret du nouveau gouvernement Monti qui en a fait un zone militarisée. Pendant les affrontements de janvier dernier vingt six activistes ont été arrêtés (dont certains sont encore en prison).
Depuis le 3 Juillet ceux qui soutiennent le mouvement dans les villes italiennes grandes et petites ont compris que ce qui est en jeu c’est le futur de tous. Les gens normaux et les indignés se sentent appelés à prendre position sur une question aussi simple que cruciale. La grande vitesse : avec l’argent de qui et pour faire quoi ?
Le mouvement s’est consolidé en tant que mouvement large et intergénérationnel, cherchant des formes de coordination avec d’autres mobilisations avant tout sur le territoire et le bien commun, (NoDalMolin, NoPontesulloStretto, la question des déchets en Campanie, le referendum sur l’eau). Le non à la grande vitesse est devenue quelque chose de plus profond, conscient et informé grâce à la mise en jeu collective des corps et des esprits. L’énorme travail d’organisation, de connaissance et communication fait auparavant par les premiers groupes d’activistes a réactivé ensuite la mémoire des luttes passées de partisans et d’ouvriers).
Critique des grands travaux et lutte sur la dette
Le mouvement, qui ne s’est amplifié que progressivement, a travaillé d’abord à examiner les caractéristiques techniques, environnementales et économiques du projet TAV. Il a su utiliser la contribution des experts techniques dans une sorte de laboratoire permanent d’apprentissage, d’élaboration et de diffusion. Au début, il s’est concentré sur les coûts pour le territoire et la santé face à des avantages économiques inexistants. Une sorte d’analyse coûts-bénéfices a été menée à front renversé contre le monde des affaires et de la politique, transversalement aux deux pôles politiques. Deuxième question : à qui profite le TGV ? De quelle manière est-il financé ? Est alors apparu le modèle de privatisation glissante propre aux grands travaux, dans lequel le plan de financement du projet met tous les investissements à la charge de l’État, et attribue les travaux aux grandes entreprises privées sans appel d’offres, ce qui fait grimper les coûts du travail et oblige à faire appel à un système de sous-traitance basé sur le travail précaire, et surexploité (une chose vérifiée sur la base des factures déjà établies en Italie pour des lignes à grande vitesse). Ce modèle de privatisation des profits et de socialisation des coûts est resté indemne dans les grands scandales de corruption des années 1990, et a été perfectionné par les gouvernements de centre gauche et légalisé par le gouvernement Berlusconi de 2002. Ainsi l’État néolibéral devient le sponsor et le financier de la marchandisation accrue des territoires et de la distribution des biens communs. Un mécanisme qui alimente la dette publique à laquelle on ne veut pas renoncer, même dans un contexte de crise aussi grave.
L’élaboration et l’assimilation de cette critique expliquent la forte présence dans le mouvement de thématiques liées d’un côté à la dénonciation de la corruption politique et des infiltrations maffieuses dans le système des appels d’offres, et de l’autre à la question de la dette publique. Nous voyons ici émerger une forme « située » de critique de ce qu’est devenu le capitalisme financiarisé, à partir de ses effets perçus comme destructifs d’un territoire dans son ensemble : hypothèque sur la vie future, et non plus seulement sur le travail, économie de la dette reportée sur le « public ». En ce sens la lutte No Tav est une lutte locale mais pas localiste. Ce qui est en jeu : le territoire non comme réappropriation égoïste d’une communauté mais comme lieu des biens communs qui renvoie au nœud crucial de la production et de la répartition de la richesse sociale générale.
Le discours NO TAV NO DETTE est en train de devenir le sens commun du mouvement et au delà, et peut devenir le pivot d’une action plus large avec laquelle porter la lutte sur un terrain crucial pour l’élargissement du mouvement.
Une critique pratique de la représentation
La conscience est de plus en plus claire qu’on résiste non seulement aux « grands travaux », mais à la crise de légitimité des pouvoirs institutionnels et à la crise de la représentation politique à l’ère post-démocratique. Les pratiques du mouvement ont saisi la base matérielle de la crise actuelle de la politique: la connexion État-banques-grandes entreprises-partis politiques. La résistance de masse pour la défense du territoire en est sortie renforcée grâce à la certitude qui s’est généralisée à un moment donné, d’agir légitimement contre une légalité formelle arbitraire de l’État et des partis. Cette affirmation d’une « autre légalité » a dû rompre à un certain moment les limites formelles de la loi de l’État et exercer son droit à la résistance sur le territoire, en bloquant les routes et les voies ferrées, avec des affrontements contre les forces de police,etc…
Ainsi nous nous sommes d’abord organisés en dehors des canaux traditionnels (partis et syndicats) qui étaient sourds aux revendications du mouvement, qui en ce sens a été précurseur des mouvements comme celui des indignés. Jusqu’à ce que la pleine autonomie devienne une valeur en soi en tant que condition indispensable pour la « question essentielle » : qui décide? Cette question est liée ici est à la défense du territoire, l’autre bien commun défendu par le mouvement à l’intérieur d’une pratique démocratique réelle, effective et autoorganisée, avec ses propres modalités, ses propres « institutions », ses propres circuits de communication, et l’exercice contextuel d’une « démocratie du contrôle » sur les institutions politiques locales. La mobilisation s’est concentrée dans ses moments chauds dans les assemblées décisionnaires où jusqu’à présent on a toujours réussi à construire des synthèses non forcées dans lesquelles l’unité du mouvement et l’efficacité de l’objectif constituent le critère partagé.
Même la dimension spatiale en est ressortie configurée. Les lieux d’agrégation et de controle du territoire, les sièges des institutions locales « réappropriées », les places, les écoles, et même les péages des autoroutes bloquées sont devenus des lieux, non fermés, parcourus par les petits groupes d’individus qui font deux choses : coopèrent dans des activités multiformes, orientées par l’objectif, et en faisant cela ils reconstruisent les liens sociaux contre l’atomisation. La capacité de coopération des gens impliqués se fonde sur le temps et sur les expériences partagées, à partir des moments de socialité au sein des comités organisés dans chaque village et dans les campements et les barricades construits à différents moments de la lutte; ce qui constitue à la fois une condition et le produit même d’un changement moléculaire des formes de vie.
« C’est de la subjectivité consensuelle et élégante qu’on semble s’être débarrassé dans la vallée de Suse ». Et ceci a permis la recherche assidue et précise de l’unité dans l’hétérogénéité des sujets, des visions, des histoires individuelles, des perspectives et même des rôles sociaux. Un processus réel, constitutivement non linéaire, d’unification de sujets sociaux, politiques, générationnels, différents – non réductibles à une perspective commune déjà donnée – s’est mis en place.
La pratique de l’enquête
Le mouvement développe une véritable autoformation dans un processus circulaire grâce auquel énergie et idées circulent plus largement. Il n’y a pas d’intellectuel « organique », la connaissance est la production de tous. Sans bien entendu soutenir ici une improbable continuité avec les expériences passées de l’enquête ouvrière et de la conricerca on remarque néanmoins que, en quelque sorte, dans le mouvement No Tav la forme enquête devient pour ainsi dire embedded, une pratique englobée sans être pour autant théorisée.
Les activistes se procurent les documents, et les analysent en les confrontant avec les expériences et la pratique du territoire, ils en discutent publiquement, en les élaborant, ils produisent de nouveaux savoirs critiques. La connaissance devient ainsi endogène au mouvement, produite en son sein. Il n’y a pas de savoir « objectif », scientifique, de dire d’expert auquel faire confiance. S’il y a un contenu technique le mouvement doit pouvoir en discuter. En même temps, le rapport avec le savoir est sur les « choses », il n’est pas idéologique, les contenus sont spécifiques sans être spécialisés. Les experts sont bienvenus mais ils ne donnent pas la « ligne »; la connaissance est connaître ensemble. Il va de soi que ceci correspond à une critique forte et précise de la propagande massmédiatique.
Le mouvement utilise les nouveaux médias, mais de manière sobre, en tant qu’instruments de diffusion et pour envoyer des signaux et renforcer les relations de face-à-face. La communication dans le réseau se révèle ainsi décisive dans les pratiques de résistance puisqu’elle agit sur les liens soit préexistants soit qui ont été créés par la lutte, auxquels s’ajoute tout le potentiel de prolifération du message et de la communication de masse peer to peer typique des nouveaux medias.
Sur cette base la communication devient aussi organisation: fluide, ouverte et non hégémonique, capable d’impliquer des sujets divers sur des objectifs communs, sans demander d’unifier les points de vue, en respectant les différentes pratiques et les formes d’expression. Avec ces modalités le mouvement parvient à se tester, à tester ses propres humeurs et perceptions, bref à réfléchir sur soi-même. Il se forme pendant qu’il s’informe.
Une nouvelle composition de classe
La composition sociale du mouvement est liée aux formes d’ancrage dans le territoire, mais politiquement transversale. À contre-jour d’un tissu interclassiste « populaire » – classe-ouvrière bien que redimensionnée, employée, vieille et nouvelle classe moyenne, « artisans », – apparaît quelque chose d’autre, qui désoriente beaucoup plus ou qui promet d’après nous, et, comme toujours dans le cas de phénomènes sociaux nouveaux, seule la lutte contribue à faire émerger, et aide à mettre au point. Ce que nous avons vu se constituer c’est la mise en connexion de simples individus privés des appartenances traditionnelles et des identités de classe propres à l’ancien cycle industriel fordiste en phase de déclin, restés sans défense organisée face à un mode de produire qui à un certain moment est apparu encore plus destructeur. Femmes et hommes réduits à la normalité, comme tous les autres, au minimum d’une existence faite de consommation et de production dans un territoire traversé par les flux de circulation des marchandises, parsemés de cathédrales de la consommation, vecteurs d’un quotidien fait d’allers et retours de masse vers une ville à la recherche désespérée de la reconversion cognitive d’un appareil manufacturier en crise.
Les individus ont bougé alors, non parce que l’émiettement des anciennes agrégations aurait dissipé les anciennes alliances de classe mais parce que avec la capacité de pénétration des rapports capitalistiques dans la reproduction quotidienne l’individu est déjà en soi un tas de relations sociales. Soumis normalement à des dynamiques aliénantes et ségrégatives ces individus, sous certaines conditions, sont à même de les retourner en construisant une communauté qui n’a rien de présupposé, en s’appuyant sur la richesse potentielle de ces mêmes relations ambivalentes qui, dans la vie de tous les jours, sont mises en valeurs non pour elles-mêmes mais pour le marché.
La lutte No Tav n’est pas contre l’accumulation primitive des infrastructures mais contre sa reproduction élargie, destructrice, dans la globalisation. La critique de No Tav s’élève « spontanément » contre l’idée de sacrifier la vie des gens à une inutile plateforme logistique et de faire du territoire un espace de « flux » absolument ouvert. Par la suite cette lutte s’est affinée contre la méthode d’appropriation privée des dépenses publiques qui à travers le système des grands travaux a non seulement rendu structurel l’endettement mais a favorisé la diffusion de relations de travail précaires, typiques de l’entreprise post-fordiste. C’est ainsi que s’est sédimentée une opposition qui veut détruire un certain type de développement qui ne propose plus d’échanges économiques au travail ouvrier et à la petite entreprise, comme dans les phases précédentes, comme compensation des dommages à la vie sociale et à l’environnement. De la dégradation de la précédente composition du travail émerge aujourd’hui plus clairement un tissu de relations productives et reproductives- l’individu social de marxienne mémoire?- qui, avec fatigue, cherchent à se forger en tant que figure « politique » adéquate au rapport de capital qui tend à couvrir le spectre de la vie.
Faire commun comme programme ?
La Vallée de Suse en lutte ne constitue pas un environnement alpin idyllique, mais plutôt une zone d’infrastructures denses, en tant qu’extension d’une métropole en restructuration. L’enjeu est un territoire innervé de relations économiques et de pouvoirs dans lesquels la vie sociale est devenue un terrain d’affrontement contre les logiques du profit non seulement en termes de défense mais de reconstruction. Le mouvement No Tav est en train de se développer sur un plan situé entre l’espace des flux globaux et marchandisés et le lieu de la vie sociale. Il est en train de le faire avec un parcours de mobilisation non traditionnel. Sa force réside dans le fait de ne pas avoir à défendre de vieilles assises et de ne disposer des instruments anciens, tout en étant fort des décennies passées, du lien entre lutte et développement capitalistique.
La ressource principale de la mobilisation est liée au fait que nous avons ici une lutte pour la reproduction de la vie sociale qui doit défendre quelque chose comme commun; L’idée que la vie – territoire, santé, mobilité, pouvoir de décision, savoir-critique non seulement doit être posée comme limite à la voracité du marché, mais doit être défendue aussi en tant que possibilité de représentation consciente et collective, telle est l’idée qui a fait son chemin. C’est ici que se définit la frontière entre un « bien public» qui peut être toujours séparé de celui qui le produit, être privatisé, même dans des formes étatiques institutionnalisées et les biens effectivement communs. Cette expérience de soulèvement et de vie est aujourd’hui cruciale en Italie en tant qu’indication de pratiques, de langage et de morceaux de « programmes » pour ce qui pourrait sortir du malaise croissant face à la reproposition des pires recettes économiques et sociales qui nous ont conduits dans le trou noir de la crise globale.
Traduit de l’italien par Antonella Corsani & Anne Querrien