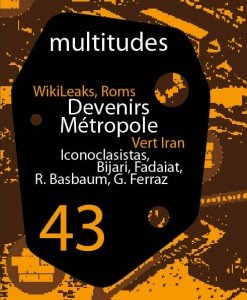La Révolution iranienne de 1979 démarqua le bord de notre époque, contemporaine du déclin du mouvement ouvrier du XXe siècle, de la fin des projets post-coloniaux et des changements structurels du capitalisme[1]. Le retour sur son histoire, proposé ici, ne cherche pas à évoquer le spectre du passé ni à retoucher les cartes postales journalistiques, mais à penser la question devant laquelle une révolution, menée au nom d’une politique spirituelle, terme emprunté à Michel Foucault[2], perdit son esprit[3]. Le pari est simple : il porte sur la condition sous laquelle l’époque actuelle est vécue.
La séquence révolutionnaire
En suivant le filigrane des mouvements qui composaient le soulèvement populaire entre le printemps 1978 et février 1979, deux composantes sont discernables : le processus autogestionnaire et les rassemblements des masses. Un bref témoignage de l’époque révolutionnaire, en 1978, rend compte du lien entre ces deux processus :
« Quelques semaines avant l’insurrection de février, une grande manifestation est passée par la Banque centrale d’Iran. Certains membres du personnel sur un sit-in de grève, sont apparus à la fenêtre de la banque pour exprimer leur solidarité avec les manifestants et l’un d’entre eux cria, “Il faut nationaliser les banques”. Les manifestants approuvèrent et depuis ce jour-là, la nationalisation des banques fit partie des revendications révolutionnaires. Durant l’été 1979, quand les forces révolutionnaires furent au contrôle de l’État, des banques ainsi que des compagnies d’assurance et de nombreuses industries manufacturières furent effectivement nationalisées[4]. »
Les formes d’autogestion issues des comités de grève se sont propagées à l’échelle nationale dès 1978. En février 1979, les conseils du travail se sont déjà établis sur une grande partie des sites industriels, dans les hôpitaux, les écoles, les universités et les bureaux gouvernementaux[5]. Ces activités étaient étroitement liées aux rassemblements dans la rue qui prenaient toujours plus d’ampleur. En Décembre 1978, environ deux millions de manifestants défilent à Téhéran en scandant « Indépendance, Liberté, et République islamique ».
La séquence révolutionnaire passe brièvement à une action armée pendant deux jours en février 1979. C’est la décomposition définitive de l’alliance entre la cour, la bureaucratie et les religieux, c’est-à-dire du modèle impérial perse existant depuis le XVIe siècle[6]. Cette décomposition avait commencé au milieu du XIXe siècle et s’était appronfondie avec la révolution constitutionnelle (1905-1907) et les mouvements sociaux des années 40 et 50.
Après la chute de la monarchie en février 1979, une série de conflits et de scissions traverse le mouvement révolutionnaire jusqu’à l’instauration d’une république qualifiée d’islamique. La nouveauté, même pour le peuple révolutionnaire, était l’ambition déclarée par Les groupements réunis autour de la figure de Khomeini : établir un ordre social juste, basé sur une morale inspirée par les pratiques des musulmans, dit islamique. Cette réclamation et ses manifestations dans la réalité ont été dès lors en proie à des ambiguïtés.
Les ambiguïté du mouvement sont d’ordinaire analysées par les experts du Moyen-Orient comme résultant d’une combinatoire de catégories telles que le rôle de la culture, le populisme de Khomeini ou le poids de la classe moyenne traditionnelle[7]. Cette transposition géographique du modèle développementiste de l’histoire de l’accumulation primitive présuppose une unité spatio-temporelle de l’« Iran » aux périphéries de notre monde présent. Or, l’expansion géographique des rapports capitalistes ne se résume pas en une simple l’appropriation des ressources primaires de nouveaux espaces. Cette expansion modifie également le fonctionnement du capitalisme en introduisant le capital dans de nouveaux territoires de la vie humaine. Il s’en suit que les catégories et le cadre développementiste disent peu de choses face à la question iranienne. Ce que j’avance n’est pas une négation de ce cadre mais une radicalisation de ses prémisses sur la notion d’unité périphérique. La Révolution iranienne est représentée, imaginée à la marge de « notre monde » alors que le destin d’une société révolutionnaire se situe précisément au bord déconnecté du monde.
Prenons l’exemple le plus trivial : la production d’images de l’Iran, soit sa représentation officielle, son encadrement médiatique par ce que l’on appelle l’Ouest. Des figures comme le fanatique, la femme vêtue en noire, la nouvelle génération, l’Islam et l’Occident, circulent dans un réseau narratif : « Une population religieuse, déterminée à rétablir un ordre traditionnel, se leva contre des valeurs occidentales et le régime pro-occidental du Chah. Maintenant, une nouvelle génération veut la circulation libre de l’information et s’intéresse aux valeurs du monde tel qu’il est. » Quel que soit le rapport de chacune des instances de ce réseau avec les faits historiques, l’évidence immédiate des signes visuels, avec tout leur attrait exotique, reproduit simplement une chaîne ordonnée de références aux traditions et aux particularités culturelles pour établir un conflit central entre un passé obscur et tout ce qui est le présent de notre monde. Le présent, le monde des relations capitalistes, se représente comme l’acte de voir, un acte sans étendu, et l’évidence se vérifie à travers l’inactualité temporelle de ces images d’ailleurs. La rupture révolutionnaire, compacte et instable, reste hors-champ de cette évidence visuelle.
Deux formes de militantisme révolutionnaire
Revenons donc sur les instances de cette séquence révolutionnaire. De la conjonction des processus autogestionnaires et des rassemblements de la rue entre le printemps 1978 et février 1979 a émergé la notion de peuple. La chute de la monarchie en février dissout pourtant cette conjonction entre l’enthousiasme des rassemblements de rue et l’autogestion comme mode d’organisation. Si l’on regarde de près les conflits entre les khomeynistes et les autres forces de gauche ou nationalistes, l’enjeu est dans les efforts divergents vis-à-vis de la notion de peuple de la révolution. La célébration du 1er mai 1979 en est un exemple[8], première manifestation publique depuis 1953. À Téhéran, quatre rassemblements différents s’expriment. Les Moudjahedines du peuple, groupe de guérilla créé dans les années soixante, musulman mais influencé alors par le radicalisme des mouvements post-coloniaux et par le communisme iranien, coordonnent quelques associations d’ouvriers dans un rassemblement séparé. De son côté, une coalition maoïste et marxiste avec la Maison des ouvriers, une structure syndicale issue de la révolution, organise le plus grand rassemblement. La troisième manifestation était organisée par l’ancien parti communiste pro-soviétique et, enfin, les khomeynistes célébrent le 1e mai pour la première et dernière fois. Une longue liste d’associations, conseils et syndicats participaient au rassemblement organisé par la gauche qui était bien plus nombreux que celui des khomeynistes, même si celui-ci a été officiellement convoqué par la radio et la télévision. Les banderoles des manifestants de la gauche revendiquaient un plus grand contrôle populaire sur les usines et lieux de travail, la réforme du droit de travail, l’égalité de rémunération entre hommes et femmes et la nationalisation de l’industrie.
Les khomeynistes, quant à eux, portaient pour la première fois des banderoles condamnant « le danger communiste ». Dans une brève allocution, Khomeini déclara alors : « Chaque jour est la journée des travailleurs puisque le travail est la source de toutes choses, du ciel à l’enfer jusqu’à la moindre particule de l’univers ». L’importance de cet épisode n’est pas son élément anticommuniste. Si les libéraux et nationalistes négligeaient traditionnellement le 1e mai, les khomeynistes s’y sont présentés, non pas pour le célébrer mais pour se réapproprier son sens. Pour les forces islamiques autour de Khomeini, l’enthousiasme massif univoque était menacé par la diversité des demandes sociales et de leurs représentations organisées. L’allocution de Khomeini n’est pas populiste, mais bascule le sens du travail d’une signification sociale vers une conception spirituelle. La fameuse phrase dans l’allocation, c’est la suivante : « Chaque jour est le jour des travailleurs parce que chaque jour est le produit du labeur divin. » La continuité ininterrompue du spirituel aux conditions matérielles de la vie, avec une saveur panthéiste, laisse entrevoir quelques exclus communistes ou syndicats, étrangers à l’enthousiasme spirituel.
À partir de l’automne 1979, les organisations populaires subissent progressivement l’attaque des khomeynistes. Au printemps 1981, ils étaient, soit éliminés, soit remplacés par des conseils islamiques étroitement liés à l’appareil étatique et la séquence révolutionnaire est close en juin, lors de la destitution du premier président de la République Bani Sadr. Une vague de répressions brutales des forces révolutionnaires a suivi. La brutalité est nettement à distinguer de la terreur révolutionnaire contre les anciens dirigeants, autant par sa cible qui est maintenant une partie des combattants contre la monarchie, que par son étendu et violence dans des milieux urbains.
L’enthousiasme et la politique spirituelle
Pour le jeune Marx, contemporain des mouvements révolutionnaires du XIXe siècle, « Il n’est pas de classe de la société bourgeoise qui puisse jouer ce rôle, à moins de faire naître en elle-même et dans la masse un élément d’enthousiasme, où elle fraternise et se confonde avec la société en général, s’identifie avec elle et soit ressentie et reconnue comme le représentant général de cette société… Pour que la révolution d’un peuple et l’émancipation d’une classe particulière de la société bourgeoise coïncident, pour qu’une classe représente toute la société, il faut, au contraire, que tous les vices de la société soient concentrés dans une autre classe, qu’une classe déterminée soit la classe du scandale général, la personnification de la barrière générale; il faut qu’une sphère sociale particulière passe pour le crime notoire de toute la société, si bien qu’en s’émancipant de cette sphère on réalise l’émancipation générale[9] ».
L’enthousiasme révolutionnaire, terme récurant dans l’idéalisme allemand, est conçu par Marx comme déterminé par le rapport d’une partie, une classe de la société à l’ensemble de ses parties. Le nom de Marx marque la conclusion historique des expériences révolutionnaires bourgeoises. Cette conclusion renverse l’acceptation idéaliste de l’enthousiasme révolutionnaire depuis Kant, c’est-à-dire l’expression d ’une morale extraconstitutionnelle pure[10]. Ce renversement n’est pas une simple prise de distance philosophique mais la reconnaîssance de l’émergence d’un moment constitutif, d’un sujet politique, immanent à l’acte de rébellion lui-même, et unificateur de la société. L’idéalisme révolutionnaire n’est non plus et seulement une idéalisme de la pensée mais avant tout l’idéalisme de la révolution, une critique morale opérante au sein des révolutions des XVIIIe et XIXe siècles.
La première séquence révolutionnaire en Iran était un cas particulier d’une telle dialectique. Une proposition générale qui pourrait intégrer le surgissement de deux formes d’organisation, l’autogestion de la production sociale et la redéfinition de l’espace public, restait inarticulée.
L’enthousiasme pétrifié engendre un ensemble d’idées, de groupements autour de la figure de Khomeini que nous désignons par le terme de politique spirituelle. Cette politique arrête le mouvement dialectique entre le moment subjectif et la société dans sa totalité, et fonctionne depuis 1981 comme gestionnaire de l’ensemble inconsistant des appareils hérités de l’ancien régime. Pour mieux comprendre ce dernier point, il faut se tourner vers le cadre juridique installé par la dite politique spirituelle.
La constitution sans exception
Six mois après la chute de la monarchie, à l’automne 1979, une assemblée dont les élections étaient source de conflits parmi des forces révolutionnaires ratifia une constitution qui prônait une nouvelle doctrine : le Guide suprême, « La République islamique est un système fondé sur la croyance en un Dieu (comme il est dit dans la phrase : “Il n’y a pas de divinité à part Allah”), Sa souveraineté exclusive, le droit de légiférer, et la nécessité de la soumission à ses commandements[11]. » Le document ratifié, comme toutes les constitutions, contient des contradictions, formulations lacunaires qui portent des traces des demandes des courants révolutionnaires. Or, le point crucial est l’exercice spécifique du pouvoir qui émerge à travers ces contradictions et ces lacunes de la constitution.
Contrairement à la notion de souverain constitutionnel, base formelle du système monarchique de l’ancien régime, la doctrine de guide suprême ne fournit pas une définition constitutionnelle du pouvoir souverain[12]. Elle l’évite d’une manière qu’on peut qualifier de « tordu ». Le guide suprême stipulé dans ce document n’est pas un médiateur entre une instance transcendante et des affaires profanes dont le lien serait réglé dans une monarchie constitutionnelle ou absolue. Il ne tient pas non plus son autorité d’une délégation représentative. Il est simplement un expert en jurisprudence, un régulateur du pouvoir étatique, élu par une Assemblée des doctes. Cette idée « papiste » au sein de ce document stipule aussi l’instance présidentielle et les droits universels des citoyens ainsi que le referendum, mais sans définir non plus la source de leur légitimité ni les institutions qui les protègent.
Le Guide suprême nomme le Conseil des gardiens de la constitution qui à son tour approuve la liste des candidats pour l’assemblée des experts qui ont à choisir le Guide suprême[13]. Ce mouvement circulaire est l’effet immédiat de ce que ni le peuple, ni la nation ni même le Guide, ne sont dotés d’un statut souverain. La seule médiation qui maintient cette procédure circulaire est la masse enthousiaste de dévots, nommée « ommat », un terme inconnu alors en Iran. Les khomeynistes transforment ce terme communautaire en un élément quasi juridique coexistant avec ceux de nation et de peuple dans le même document[14]. L’ommat présente une masse unie au Guide suprême. Leur rapport n’étant pas de l’ordre représentatif, le terme n’a aucune consistance en soi mais introduit une torsion dans la procédure circulaire. L’absence d’une définition de la souveraineté n’est pas due à une ignorance de la part des députés de cette assemblée en 1979. Selon les protocoles de leurs délibérations, on savait se référer et à la constitution de 1905, et aux textes classiques comme le Léviathan. La doctrine du guide suprême autorise le choix d’un savant, un docte en fonction d’un index de qualités préétablies. L’infondé, moment politique de la déclaration de la souveraineté par le peuple de la révolution est remplacé par une rationalité qui évite la fonction symbolique du souverain. Par-là, et de manière paradoxale, on évite de refonder l’État. Si l’émergence du peuple révolutionnaire pendant la première séquence de la Révolution a dissout l’alliance historique entre le Chah, la bureaucratie et la religion, le même peuple ne pouvait se représenter que comme « ommat », le nom propre de l’univocité en masse qui supprime la possibilité d’un lien entre le sujet et le collectif.
La politique spirituelle ne fonda donc pas une nouvelle forme d’État. Elle fut la « crise de fondation » dans le sens que Carl Schmitt donne à ce terme. Tout en gardant les appareils hérités d’un État rentier structurellement lié aux circuits du capital pétrolier[15], au fond, la République était un mode d’exercice du pouvoir réglé par décret du Guide suprême.
La prothèse de l’État
La politique spirituelle marque donc l’échec de la refondation de l’État. Certes, cet échec porte la trace de l’absence d’une cause publique, une res publica, qui opère sur le rapport entre un moment subjectif et le collectif. Elle est néanmoins plus qu’une représentation négative de cette absence. En tant que mode de gouverner, elle transforme cette absence en un composant de sa reproduction : La communion du Guide et des masses (l’ommat) maintient la machine étatique, une « prothèse » de l’État en quelque sorte.
Pour éclairer la portée de ce mode prothétique au sein du capitalisme contemporain, il me semble décisif de réviser la notion de la vie nue, proposée par Agamben[16] comme limite déterminante et intérieur de l’ordre actuel. La vie nue, en tant que telle, isolé des relations sociales n’est que un fantasme. Elle s’impose comme une réalité effective car l’exercice du pouvoir dans le capitalisme contemporain consomme et consume son propre moment politique de fondation. Le dogme du réalisme courant englobe toute existence et réclame: « Une cause plus grande que la vie nue est nécessairement inexistante ». Il n’est aucunement une négation simple d’une cause immanente au sein des relations sociales, il la rend inarticulable. Le monde ordonné selon ce dogme est vécu comme si une vie dépourvue de tous les liens sociaux pourrait subsister. La logique qui gouverne le dogme contient un moment du déni présenté comme une condition absolue. Il ne dit que ceci : « s’il y a une cause plus grande que la limite extrême de notre monde, c’est-à-dire la vie nue, elle est nécessairement inexistante ». Autrement dit, elle doit rester inexistante. La politique spirituelle s’inscrit dans la même logique, c’est-à-dire il assume la vie nue comme une limite opérante mais révèle en même temps la possibilité d’une torsion inhérent à la logique du dogme, par laquelle la cause sociétale se transforme en une Chose imaginaire accessible à condition de nier la vie.
La politique spirituelle confond dans un premier temps la vie nue, isolée idéalement des relations sociales, avec l’impossibilité empirique de la construction d’une cause. La cause sociétale, la question posée par la révolution, disparaît dans un deuxième temps derrière une réinscription de la nécessité d’inexistance d’une cause, cette fois-ci au niveau de l’être et comme une Chose sacrée, omniprésente et à la fois accessible. La politique spirituelle, elle finit donc par l’impératif de l’anéantissement de la vie nue.
Le Guide suprême de la politique spirituelle, en union avec les masses des dévots, n’est que l’envers de la vie nue. Certes, la politique spirituelle établit un lien qui supplée les rapports sociaux dans un contexte où l’avancée de marchandisation dicte la condition absolue comme limite des relations sociales capitalistes, mais elle le fait comme une négation du peuple de la révolution et une prothèse pour que l’État tienne debout. Le culte des martyrs après 1981, cette réminiscence de l’autel sur lesquel a été sacrifié l’ancien monde, souvent préprogrammées par les médias pendant la guerre contre l’Irak, la brutalité extrême contre les organisations politiques indépendantes après 1982, ces exclus du plan divin, ainsi que le pur arbitraire des codes de comportement des femmes et des hommes, ces inventions au nom de la tradition, ne sont que des formes de la mise à l’écart d’une cause immanente mais non constituable, une torsion du dogme global. Ce qui relie le Guide suprême et sa base des masses des dévots amorphes, anonymes, ce qui donne un minimum de cohérence à l’arbitraire et à la brutalité, ce qui fait marcher ce mode spécifique de gouverner, bref ce qui supplée l’absence de la cause, n’est que la place que la vie nue, l’animalité humaine, occupe à l’intérieur du dogme global.
La Révolution iranienne, en revanche, se trouve au bord déconnecté de notre monde. La notion de limite, telle qu’elle opère dans ce que nous avons appelé le dogme global, est le voisinage d’un point extrême toujours à l’intérieur d’un continu[17]. Tandis que le bord, la Révolution avec sa question, indique la proximité immédiate de ce qui apparaît comme un autre monde.
Le maillon faible
La question iranienne pose la question de la possibilité d’articuler une cause qui fait lien entre le moment subjectif et le collectif. Elle n’est pas une question des iraniens, mais une question révolutionnaire qui s’impose aux iraniens dans une société où les antagonismes locaux s’imbriquent dans les restructurations mondiales du capitalisme. Il est nécessaire de caractériser la séquence historique 1978-1982 et ses conséquences comme une partie limitée de la Révolution elle-même. Cette séquence se définit essentiellement par l’impossibilité de constituer un État qui correspondrait à l’émergence du peuple révolutionnaire, d’où la crise sociale qui s’en suit et le triomphe de la politique spirituelle. Mais une nouvelle séquence s’ensuit produite logiquement par les circuits de l’accumulation et de la distribution des valeurs du capitalisme contemporain.
La société iranienne, frappée par une crise sociale à l’issue de la première séquence, se trouve toujours dans une époque révolutionnaire. La Révolution iranienne n’en est encore qu’à ses débuts.