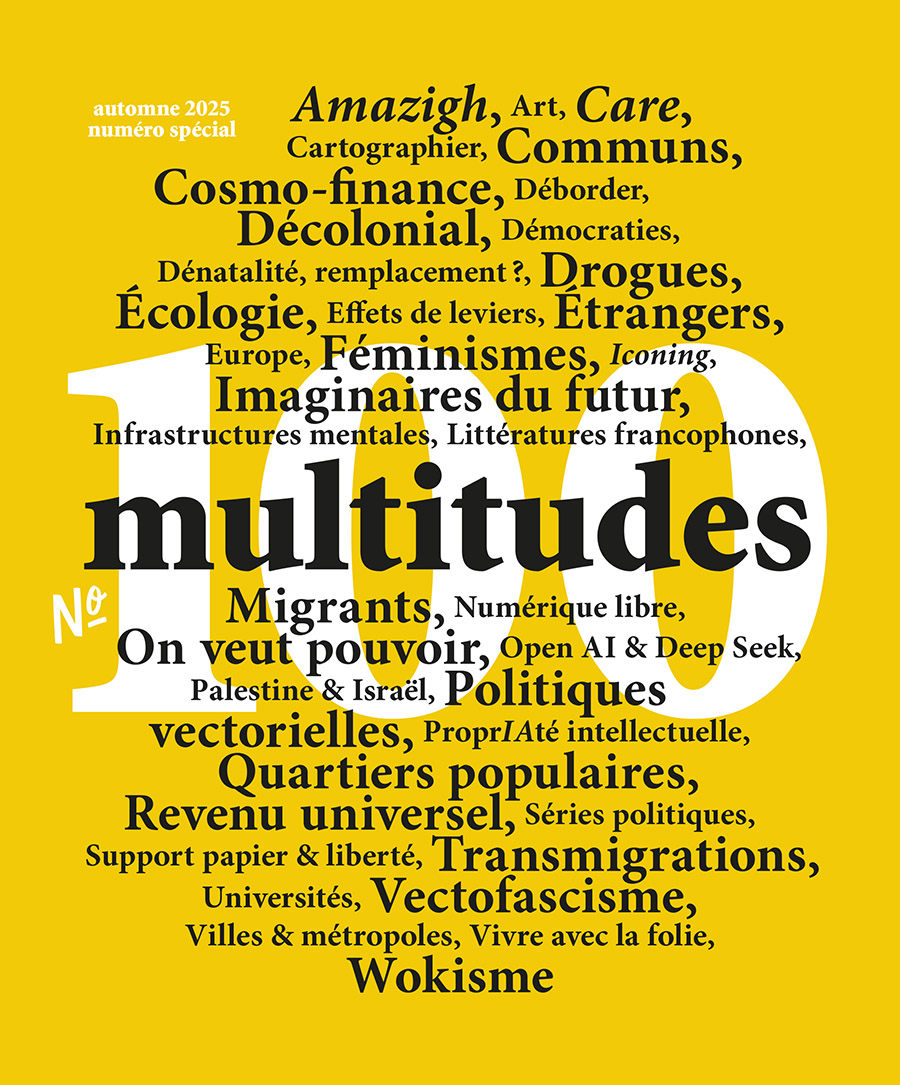Montre tes blessures, par Attia Kader
L’histoire commence en 1996 au Congo-Brazzaville. Mon ami Titi Nganga m’y a offert un vieux morceau de tissu en raffia, un Nchakokot, sur lequel on avait cousu des morceaux de tissu venu d’occident. Je fus immédiatement surpris de cette intrusion décorative inattendue. En examinant attentivement l’envers de la pièce, j’ai remarqué que chaque morceau de … Continuer la lecture de Montre tes blessures →
« Né to set it right », par Gaëtane Lamarche-Vadel
Dettes et anamnèse Kader Attia voyage dans le temps à travers les archives qu’il glane aux puces de Berlin ou de Paris. Il collectionne les cartes postales et les journaux de la fin du XIX et du XXe, Le Petit Journal, Le Petit Français, L’Illustration, Les faits divers illustrés, etc., dont les images exhibent des … Continuer la lecture de « Né to set it right » →
Introduction, par Amer Meziane Mohamed
Pourquoi une République dite « laïque » réduit-elle systématiquement des citoyens à leur appartenance « religieuse » supposée ? Pourquoi des inégalités sociales, concrètes et matérielles, prennent-elles la forme de conflits « religieux » au moment où l’on crie « laïcité » sur tous les toits ? « Décoloniser la laïcité » est une hypothèse … Continuer la lecture de Introduction →
La laïcité répressive. Anthropologie et géopolitique de l’homo laïcus, par Sibertin-Blanc Guillaume et Boqui-Queni Laëtitia
Naufrage de Lampedusa, par Rodier Claire, Gisti et Migreurop
Si ce n’est son extrême proximité de la côte, rien ne distingue le terrible naufrage survenu à Lampedusa le 3 octobre 2013 de ceux qui l’ont précédé ou suivi. La compassion mêlée d’effroi qui s’est emparée de la population locale, des médias et de la classe politique européenne à l’annonce de la mort par noyade de … Continuer la lecture de Naufrage de Lampedusa →
La première révolte de la multitude du travail métropolitain, par Cocco Giuseppe
Des manifestations massives de mécontentement tant à l’égard de la politique que de la politique économique se sont produites au Moyen-Orient, en Espagne, à Wall Street. Elles touchent désormais le Brésil. Pour quelles raisons ? Que représentent ces mouvements sociaux actuels ? Giuseppe Cocco : Disons tout de suite que ce qui caractérise ces manifestations, … Continuer la lecture de La première révolte de la multitude du travail métropolitain →