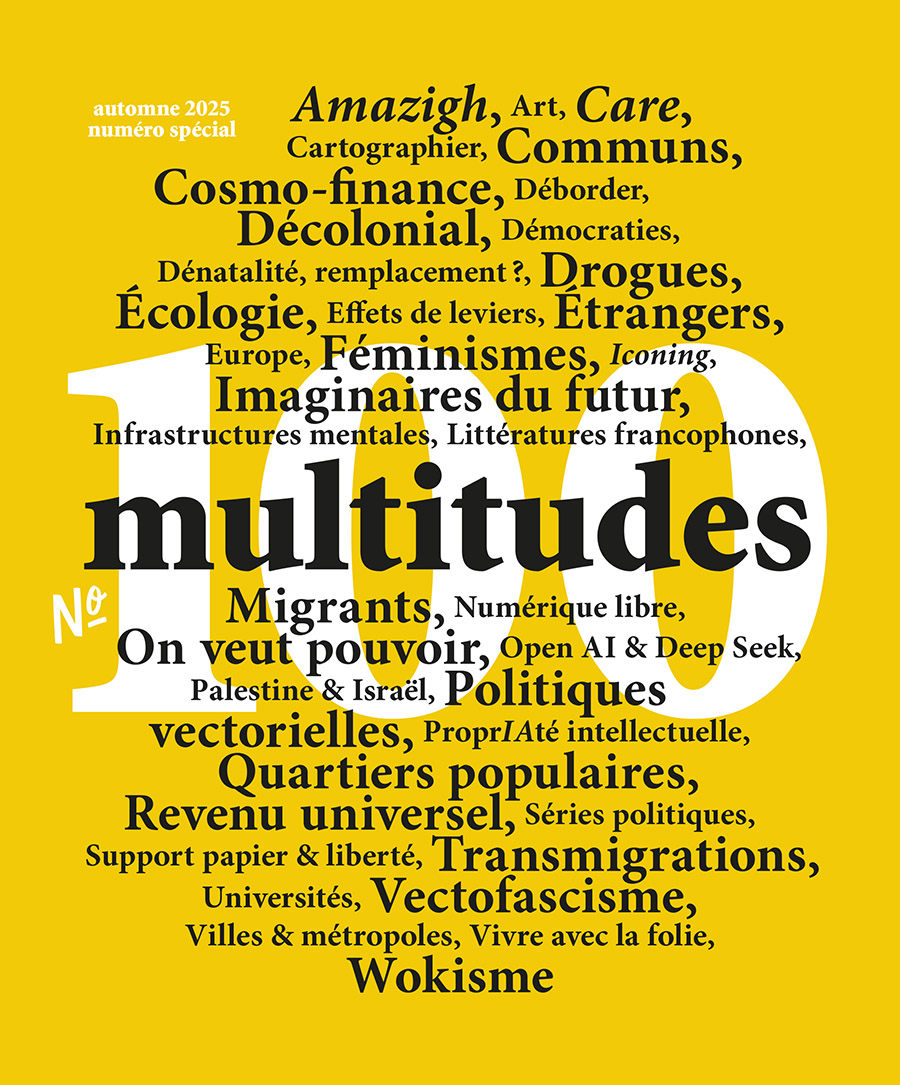Le don perdu, par Karsenti Bruno
Il y a une histoire du don, solidairement envisagé comme fait sociologique et comme concept, qui parvient aujourd’hui jusqu’à nous avec un écho retentissant. En sociologie comme en philosophie, le thème est à l’honneur : on cherche dans l’esprit du don, dans sa gratuité et son caractère d’anomalie économique, un éclairage inédit sur le lien … Continuer la lecture de Le don perdu →
Le don ou la tentation de l’en-deçà, par Nicolas-le Strat Pascal
Les automatismes du marché sont si prégnants que la pensée contemporaine a oublié jusqu’à l’idée même de leur possible subversion. La crise du marxisme est passée par là ! La logique de marché ne saurait être mise en cause, tout au plus s’autorise-t-on à regretter certains de ses excès. Certes, personne n’ose prétendre que le … Continuer la lecture de Le don ou la tentation de l’en-deçà →
À propos de la “Misère du monde” : Politique de la sociologie, par Maler Henri
« La sociologie ne vaudrait pas une heure de peine si elle devait être un savoir d’expert réservé aux experts » P. Bourdieu, Questions de Sociologie, p. 7. ———- Les Règles de l’Art et La Misère du Monde sont l’occasion, dans leur « post-scriptum » respectif, d’une « prise de position normative »[[Les Règles de … Continuer la lecture de À propos de la “Misère du monde” : Politique de la sociologie →
L’organisation sociale de l’expérience, par Quéré Louis
« Je voudrais encore renoncer à un droit. Ce livre traite de l’organisation de l’expérience – ce qu’un acteur individuel peut abriter dans son esprit – et non de l’organisation de la société. Mon intention n’est nullement d’aborder les objets centraux de la sociologie, à savoir l’organisation sociale et la structure sociale. Ces problèmes ont … Continuer la lecture de L’organisation sociale de l’expérience →
Le débat des raisons Sur J-C Passeron, “Le raisonnement sociologique”, par Verret Michel
Grande tentation de commencer ce livre[[J.-C. Passeron, Le raisonnement sociologique (l’espace non-poppérien du raisonnement naturel), Nathan, Paris, 1991. par l’axiomatique où il se conclut[[XVI, Le raisonnement sociologique. Propositions récapitulatives, p. 357-405. en si rigoureux enchaînement de propositions que tout y est dit. Mais aussi n’a-t-on plus rien à dire… Puisque l’enchaînement des propositions ne vient … Continuer la lecture de Le débat des raisons Sur J-C Passeron, “Le raisonnement sociologique” →
Micro-ethnographies : l’analyse du vécu au service des experts, par Nicolas-le Strat Pascal
Avec l’épuisement du modèle fordiste de régulation, ce que l’on identifie aussi comme la crise de l’État providence, ce qui est remis en cause, c’est un certain mode d’intellectualisation de la Question sociale, une manière de la représenter et de la réfléchir, celle qui s’invente à la fin du XIXe siècle avec les prémices d’un … Continuer la lecture de Micro-ethnographies : l’analyse du vécu au service des experts →
Durkheim : du descriptif au normatif, par Jankelevitch Sophie
Est-il possible de produire sur le monde social un discours scientifique purement positif qui soit dépourvu de toute orientation normative ? Que la sociologie soit toujours porteuse d’un projet politique, explicite ou implicite, c’est assez évident ; qu’un tel projet ait été déterminant dans la constitution même de la discipline, Durkheim le reconnaît lui-même, lorsque, … Continuer la lecture de Durkheim : du descriptif au normatif →
Sociologies en temps de crise, par Vincent Jean-Marie
Il n’y a jamais eu de sociologie véritablement unifiée. Des écoles ou des courants ont pu à certains moments dominer la scène, c’est-à-dire les institutions universitaires et de recherche, cette domination n’a jamais été sans partage. Il faut naturellement se féliciter de cette diversité : le pluralisme des sociologies permet des affrontements qui peuvent se … Continuer la lecture de Sociologies en temps de crise →
Essai sur Pierre Naville, du surréalisme à la sociologie, par Rolle Pierre
Y a-t-il une unité de la pensée de Pierre Naville, qui se continuerait à travers ses réflexions surréalistes, ses analyses politiques, ses recherches en sciences humaines ? Si cela était, on n’aurait chance de la localiser qu’au-delà, et par une méthode qui consisterait à choisir chaque fois la plus lointaine et la plus exigeante des … Continuer la lecture de Essai sur Pierre Naville, du surréalisme à la sociologie →
L’école de la régulation face à de nouveaux problémes, par Negri Toni
L’école de la régulation ne fait-elle pas désormais partie d’un passé révolu ? Le modèle de relations sociales sur lequel est fondée son analyse n’est-il pas définitivement dépassé, y compris dans les nouvelles moutures proposées par un certain nombre d’auteurs de cette école, et n’est-il pas responsable de l’enterrement de l’approche régulationniste ? L’ATR ne … Continuer la lecture de L’école de la régulation face à de nouveaux problémes →
L’Algérie aux prises avec l’histoire, par Berger Denis
Vue d’Europe, l’Algérie semble échapper au présent. Elle vit du passé, de multiples fois reconstruit, qu’a tramé la guerre de libération nationale. Son avenir apparaît immédiatement redoutable, à la lumière des progrès de l’islamisme radical. Entre le mythe et la crainte qu’inspire le lendemain, la réflexion rationnelle trouve peu de place. Pourtant, l’Algérie demeure au … Continuer la lecture de L’Algérie aux prises avec l’histoire →
Un travail au long cours : à propos de l’ouvrage de Georges Mendel : ” La société n’est pas une famille”, par Clot Yves
Georges Mendel a publié La société n’est pas une famille (de la psychanalyse à la socio-psychanalyse)[[Éditions de la Découverte, 1992. en 1992[[Plus récemment, aussi chez le même éditeur, il a fait paraître, avec M. Weiszfeld et Ph. Raman, Vers l’entreprise démocratique, récit d’une expérience pionnière. L’intérêt de ce dernier ouvrage n’échappera pas à ceux dont … Continuer la lecture de Un travail au long cours : à propos de l’ouvrage de Georges Mendel : ” La société n’est pas une famille” →
Les casse-tête du matérialisme, par Virno Paolo
I – Tout [[Texte extrait de AA. VV., Il filosofo in borghese, Manifestolibri, Roma, 1992, p. 57-66.le monde peut renoncer un jour ou l’autre à enquêter sur la relation entre vie et philosophie, tout le monde, sauf le matérialiste qui se fait un point d’honneur de démontrer la genèse non théorique de la théorie. En … Continuer la lecture de Les casse-tête du matérialisme →
Les pauvres s’organisent au Brésil, par Stedile Joao Pedro
Stédile – Un gouvt populaire, comme celui de Lula, a besoin que le peuple s’organise, sinon il restera prisonnier des banquiers, des constructeurs, du capital étranger, des maîtres des moyens de communication. Et plus encore : des parlementaires conservateurs qui représentent l’élite brésilienne. Le chemin sans retour que nous voulons construire, pour accepter sa provocation, … Continuer la lecture de Les pauvres s’organisent au Brésil →
Suite du débat sur les grèves Lula et le pouvoir, par Frédéric Brun
Greta : Moi ce qui me gène le plus dans ton analyse, Beppo, c’est que tu persistes à ne faire aucune différence entre les GROS avantages d’une minorité de travailleurs publics des TRES PODERES (trois pouvoirs : justice, exécutif, législatif) et les salaires et pensions des autres travailleurs. Un petit exemple personnel : retour au … Continuer la lecture de Suite du débat sur les grèves Lula et le pouvoir →
La mort de Feyerabend Une pensée en mouvement, par Stengers Isabelle
Ce que l’on définirait comme “la pensée de Feyerabend”, pour la commenter, la critiquer, la porter aux nues, n’existe pas. Peu de penseurs ont pris autant de soin que lui pour le faire savoir: Adieu à la raison (AR) est littéralement truffé de repentirs sans repentir, de mises à distance sans mise en jugement. “Parfois, … Continuer la lecture de La mort de Feyerabend Une pensée en mouvement →
Au fil des nouveautés critiques, par Vakaloulis Michel
ACTUEL MARX, n° 17, Théorie de la régulation, théorie des conventions, PUF, Paris, 1995, 224p. Un riche dossier avec la participation de Robert Boyer, Alain Lipietz, Paul Boccara, Renato di Ruzza, Bruno Théret, Jacques Sapir, Suzanne de Brunhoff, Michel Vakaloulis, Olivier Favereau et Jacques Bidet. AMIN Samir (avec une collaboration de Joseph VANSY), L’ethnie à … Continuer la lecture de Au fil des nouveautés critiques →
Revue des revues, par Le Digol Christophe
Cette nouvelle rubrique parue pour la première fois dans le numéro 1994/5-6 (n° 25-26) veut contribuer à faciliter la connaissance d’initiatives éditoriales et tenter de raccourcir le temps qui sépare souvent l’usage d’un travail de réflexion du moment de sa production faciliter son appropriation scientifique Actes de la Recherche en Sciences Sociales, n° 105, décembre … Continuer la lecture de Revue des revues →
Une pensée du retrait, la sociologie du quotidien de M Maffesoli, par Nicolas-le Strat Pascal
La socialité est confrontée à l’excroissance actuelle du monde des systèmes (administratif et économique). Leur omniprésence est telle que peu d’activités échappent à leur détermination. La totalité sociale est ainsi recomposée en fonction des exigences de reproduction et de stabilisation de ces dispositifs systémiques; Habermas[[Dans “Théorie de l’agir communicationnel”, Fayard, 1987. qualifie ce processus de … Continuer la lecture de Une pensée du retrait, la sociologie du quotidien de M Maffesoli →
Les coûts sociaux de la privatisation en Pologne, par Jarosz Maria
Le printemps 1992 correspond à une période de bipolarisation très sensible concernant les attitudes de la société polonaise vis-à-vis des voies qu’emprunte la transformation de l’économie. Ceci est dû notamment aux expériences de ces dernières années, durant lesquelles le groupe des salariés le plus nombreux et le plus faible économiquement a été le premier à … Continuer la lecture de Les coûts sociaux de la privatisation en Pologne →
Les années souterraines (-) de D Lindenberg, par Berger Denis
[[D. Lindenbergs, Les années souterraines (1937-1947), Paris, Découverte, 1990, 408 p. Collection l’Aventure intellectuelle du XXe siècle.En 1940, soixante-dix ans d’histoire se sont effondrés d’un coup et la France, débarrassée de la République, a pu retourner à ses fantasmes originaires, sous la houlette d’un vieillard, sénile mais militaire. En apparence, tout est simple dans cet … Continuer la lecture de Les années souterraines (-) de D Lindenberg →
Philosophie de l'”Aufklärung” et tradition : une introduction à NLuhman, par Pizzi Gian-Carlo
L’auto-réflexion constitue moins un problème d’Histoire de la philosophie (ou d’Histoire de l’histoire de la philosophie) qu’un problème théorique fondamental qui implique un jugement sur le sens même du parcours historique de la civilisation occidentale, jusqu’au déploiement de la nouvelle dimension de l’histoire mondiale. Ce jugement est, en son essence, un jugement politique. Dans Holzwege … Continuer la lecture de Philosophie de l’”Aufklärung” et tradition : une introduction à NLuhman →
Ontologie, langage et politique, par Frédéric Brun
Jacky : Il y a des textes dont on peut mesurer la force à la façon dont ils nous font penser l’événement passé et à venir. Le texte de Valérie Marange est un de ceux-là: fabuleuse coupe à travers l’histoire( radio Loraine Coeur d’Acier, mouvements sociaux des années 80, référence à l’anarcho-syndicalisme des années 30, … Continuer la lecture de Ontologie, langage et politique →
Table ronde “La multitude contre la guerre”, par Lesage Dieter
Quand on parle de la dimension critique de l’art visuel, il est difficile de faire abstraction des dialogues – sur la société, la politique, l’économie et la fonction que l’art pourrait y occuper- dans lesquels la plupart les artistes souhaiteraient que leurs œuvres soient inscrites. Un tel espace discursif est l’élément central de Revolution/Restoration, une … Continuer la lecture de Table ronde “La multitude contre la guerre” →
Qu’est-ce que la politique?, par Zarifian Philippe
Je n’épouse en rien la conception de Schmitt. Mais cela vaut le coup de la connaître à fond, car il reste, implicitement ou explicitement, une référence pour les pensées de type “néoconservateurs américains”. Et ne la voit-on pas sous-jacente à certaines interprétations de Marx ,? (mais Marx n’a jamais épousé cette conception d’une lutte des … Continuer la lecture de Qu’est-ce que la politique? →
La Justice et la Guerre, par Zarifian Philippe
Nous vivons une période très particulière, très risquée. Nous voyons bien que la normativité juridique, à prétention fonctionnelle et régulatrice, est en train de s’effondrer, et ceci dans tous les domaines du droit institué, et dans toutes les dimensions géographiques (le déplacement du national à l’européen et à l’international ne fait, paradoxalement, qu’accentuer cette décomposition). … Continuer la lecture de La Justice et la Guerre →
Travail immatériel et subjectivité, par Negri Toni
Vers l’hégémonie du travail immatériel Vingt ans de restructuration des grandes usines ont abouti à un étrange paradoxe. En effet, c’est à la fois sur la défaite de l’ouvrier fordiste et sur la reconnaissance de la centralité du travail vivant de plus en plus intellectualisé dans la production, que se sont constituées les variantes du … Continuer la lecture de Travail immatériel et subjectivité →
Ours de Futur Antérieur, par Revue Multitudes
Du n°1 au n°38 Futur Antérieur est édité par les Éditions L’Harmattan 5-7 rue de l’École polytechnique 75005 Paris POLITIQUE – SOCIOLOGIE -PHILOSOPHIE – PSYCHANALYSE – CULTURE. Directeur de publication : Jean-Marie Vincent Comité de rédaction : Claude Amey, Saverio Ansaldi, Denis Berger, Alisa del Ré, Michael Hardt, Helena Hirata, Bruno Karsenti, Maurizio Lazzarato, Henri … Continuer la lecture de Ours de Futur Antérieur →
Pratique de la guerre symbolique, par Act Up-Paris
Pour une politique de la vie en première personneEntretien avec Emmanuelle Cosse, Stany Grelet, Philippe Mangeot, Jérôme Martin militants de ACT UP Paris. Réalisé par Antonella Corsani de la revue Multitudes Version originale française d’un texte d’abord oublié en italien sous le titre “Guerra simbolica e politica della vita” dans Derive Approdi n° 22(voir http://www.deriveapprodi.org/rivista/22/guerrasimbolica.htm) … Continuer la lecture de Pratique de la guerre symbolique →
Divergences solidaires, par Puig de la Bellacasa Maria
Autour des politiques féministes des savoirs situésLa politisation féministe de l’expérience, le personnel est politique, a atteint les savoirs dits scientifiques. Les théorisations de ces politiques en termes de construction de ” savoirs situés ” défient la tradition épistémologique moderne. Affirmant un style politique qui chérit les divergences solidaires ces théories prolongent la vivacité de … Continuer la lecture de Divergences solidaires →