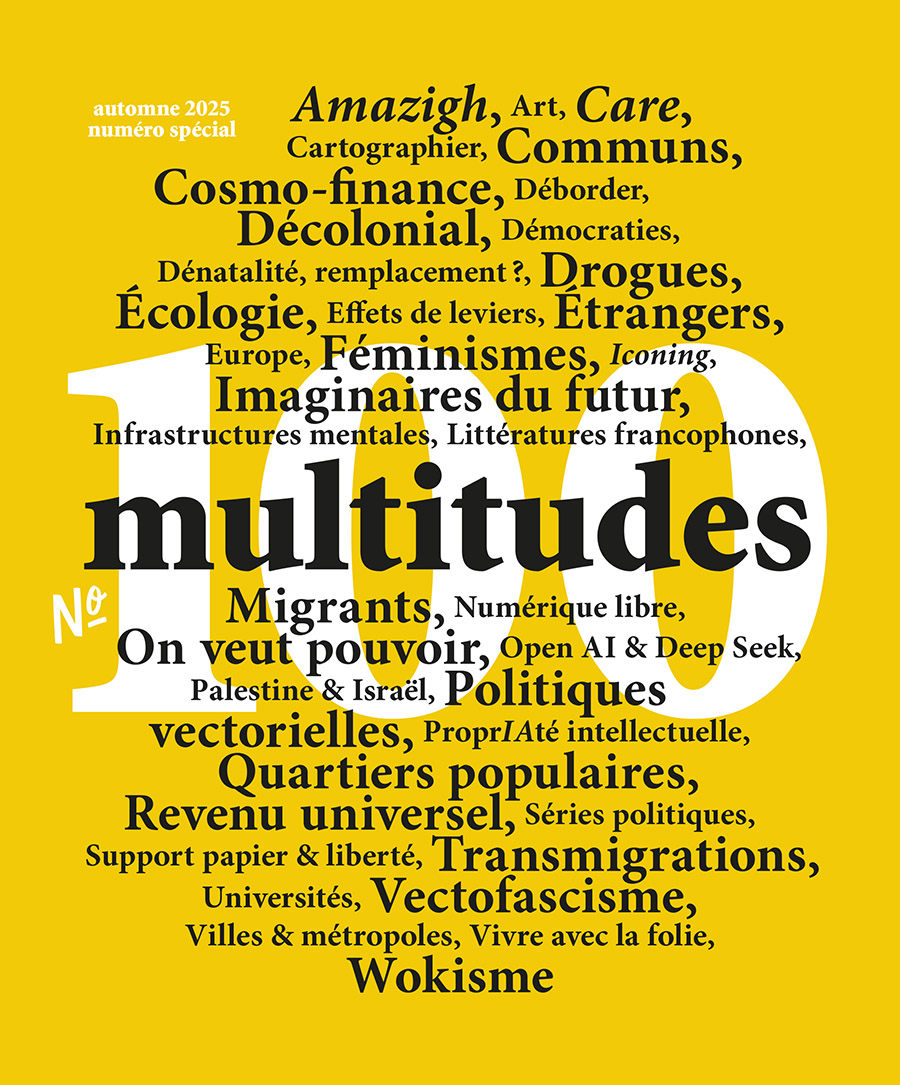La science politique et la transition démocratique à l’Est, par Guilhot Nicolas
Le redéploiement de la science politique sur les décombres de la soviétologie s’est caractérisé essentiellement par l’émergence du concept de « transition démocratique » ou, pour certains, de transition tout court. L’importance croissante que prend ce concept[[On a pu ainsi entendre dire que la « transitologie » supplanterait bientôt la « soviétologie ». et sa … Continuer la lecture de La science politique et la transition démocratique à l’Est →
Immanence et division, par Frédéric Brun
Antonia : Ce que je comprends pas c’est la compatibilité de tout : Rancière fustige le consensus mais ce qui s’y oppose n’est pas le système clos c’est la dissension. Empire est une pensée de l’immanence qui est à l’opposé strict de Rancière etc… François : Personnellement je n’ai jamais trouvé que ce qu’écrit Rancière, … Continuer la lecture de Immanence et division →
Au fil des nouveautés critiques, par Vakaloulis Michel
ANSART Pierre (textes réunis et présentés par), Rencontres autour de Pierre Fougeyrollas, L’Harmattan, Paris, 1993, 288p. BIDET Jacques (sous la direction de), Les paradigmes de la démocratie, PUF, coll. « Actuel MarxConfrontation », Paris, 1994, 270p., 198FF. L’ouvrage rassemble les communications présentées au Colloque du CNRS, Les paradigmes de la démocratie, Paris, 29-30 mai 1990. … Continuer la lecture de Au fil des nouveautés critiques →
Les méandres du pouvoir De la domination à la liberté, par Vincent Jean-Marie
Dans son livre Faktizität und Geltung (Facticité et validité), Jürgen Habermas entend jeter les fondements d’une théorisation communicationnelle ou discursive du droit et de l’État qui permettrait de dépasser les différentes variantes du positivisme juridique et du fétichisme de la force ou de la violence dans la conception de l’étatique. Pour lui il n’y a … Continuer la lecture de Les méandres du pouvoir De la domination à la liberté →
Du pouvoir politique et poïetique : schéma d’un raisonnement, par Le Doaré Hélène
“L’injustice de la société, c’est que le subordonné doit comprendre ce qu’est le pouvoir”. – Richard Sennett En fait, parler du pouvoir, c’est parler aussi de soi et de la vie. L’expérience fondamentale – celle qui fonde la vie de chaque individu, ne lie-t-elle pas de façon intrinsèque amour et pouvoir, relations affectives et rapports … Continuer la lecture de Du pouvoir politique et poïetique : schéma d’un raisonnement →
Mobilisations et travail de mobilisation autour du droit à l’emploi : l’exemple du CIP, par Roulleau-Berger Laurence
Introduction En mars 1994, le gouvernement Balladur, dans le cadre de la lutte contre le chômage des jeunes, propose comme mesure d’insertion le contrat d’insertion professionnelle (CIP), qualifié de SMIC-Jeunes, qui devait permettre aux jeunes de niveau V (CAP) jusqu’au niveau III (bac +2) de bénéficier d’une rémunération inférieure au salaire minimum fixé par la … Continuer la lecture de Mobilisations et travail de mobilisation autour du droit à l’emploi : l’exemple du CIP →
David Rieff, A Bed for the Night Humanitarianism in Crisis (New York: Simon & Schuster, ), pp, par Rackley Edward
If there is any outsider worthy of the name, David Rieff has come to be seen by many of us as a kind of “fellow traveler” to the humanitarian movement, with its critical spirit and ethic of action. Rieff is an American journalist who rose to prominence covering the Bosnian war in the mid-nineties, particularly … Continuer la lecture de David Rieff, A Bed for the Night Humanitarianism in Crisis (New York: Simon & Schuster, ), pp →
Virtuosité et révolution : notes sur le concept d’action politique, par Virno Paolo
I De nos jours[[Ce texte a paru dans la revue Luogo Comune 4/1993, Rome, rien ne semble aussi énigmatique que l’action. Aussi énigmatique qu’elle est inaccessible. On pourrait dire, sur le mode de la plaisanterie : si personne ne me demande ce que c’est que l’action politique, je crois le savoir ; si je dois … Continuer la lecture de Virtuosité et révolution : notes sur le concept d’action politique →
Il gioco, par SheSquat
Version originale dont une partie a été traduite dans art370, rub141Il desiderio di modellare il significato di autoinchiesta su di un piano corale, autonarraivo e nello stesso tempo frastagliato, ci ha coinvolte in un esperimento attivo sul tema. Abbiamo accolto con entusiasmo l’idea che un’autoinchiesta circa le trasformazioni del mondo femminile si svolgesse con una … Continuer la lecture de Il gioco →
Passer à l’action? Remarques sur la psychologie des sociologues, par Clot Yves
On n’y échappe pas : les sciences humaines, et tout particulièrement la sociologie, sont le théâtre d’une forte relance des « théories de l’action ». Cette relance s’alimente au regain d’intérêt de beaucoup de chercheurs pour la dimension philosophique du problème. Sous l’effet du reflux de la figure marxiste de l’action historique, la confrontation des … Continuer la lecture de Passer à l’action? Remarques sur la psychologie des sociologues →
L’organisation sociale de l’expérience, par Quéré Louis
« Je voudrais encore renoncer à un droit. Ce livre traite de l’organisation de l’expérience – ce qu’un acteur individuel peut abriter dans son esprit – et non de l’organisation de la société. Mon intention n’est nullement d’aborder les objets centraux de la sociologie, à savoir l’organisation sociale et la structure sociale. Ces problèmes ont … Continuer la lecture de L’organisation sociale de l’expérience →
“Etat d’exception” de G Agamben (Seuil), par Salomon Sandra
Agamben , part de ce fait que manque une théorie de l’état d’exception dans le droit, bien que, la création volontaire d’un état d’exception , ou état d’urgence, soit devenue une pratique courante et durable des Etats dans la période que nous vivons, même dans les Etats qui se nomment démocratiques. Cette pratique permanente des … Continuer la lecture de “Etat d’exception” de G Agamben (Seuil) →
Althusser et Machiavel : la politique après la critique de Marx, par Vatter Miguel
Après 1977, la pensée d’Althusser effectue un « tournant » en s’écartant du Marxisme-léninisme. Les écrits posthumes de cette période tardive constituent une source d’inspiration extrêmement riche pour une pensée post-marxiste. On peut y trouver une réfutation des erreurs du marxisme-léninisme qui selon Louis Althusser auraient deux racines : d’un coté la dévaluation et l’incompréhension … Continuer la lecture de Althusser et Machiavel : la politique après la critique de Marx →
SARS and Multitudes, or European Multitudes?, par Solomon Jon
I have tried writing this in French, and while it worked okay (with lots of patience expected from the reader) it simply takes me too much time. Like every other laborer, I am subject to the laws of time in relation to work, and have already committed a huge amount of “temporal resources” to the … Continuer la lecture de SARS and Multitudes, or European Multitudes? →
Traiter, Régler, par Jugnon Alain
Traiter / règler ? est-ce qu’on ne pourrait pas alors dire cela : le politique c’est la règle, la politique c’est le traitement ? la question “que faire ?” dit ainsi premièrement qu’il faut penser les conditions du faire pour savoir quoi faire (qu’est-ce que faire ?) et qu’ensuite il faut établir le faire lui-même … Continuer la lecture de Traiter, Régler →
Qu’est-ce que la politique?, par Zarifian Philippe
Je n’épouse en rien la conception de Schmitt. Mais cela vaut le coup de la connaître à fond, car il reste, implicitement ou explicitement, une référence pour les pensées de type “néoconservateurs américains”. Et ne la voit-on pas sous-jacente à certaines interprétations de Marx ,? (mais Marx n’a jamais épousé cette conception d’une lutte des … Continuer la lecture de Qu’est-ce que la politique? →
Pour Hannah Arendt, la politique fait exister l’agir en commun, par Salomon Sandra
Comme le dit Blaise Buscail, pour Arendt la politique est rare et surtout décrite par elle telle qu’elle fut et ne peut plus être : grecque, romaine, aristocratique. En effet le modèle de la politique pour Arendt, ses références explicites, pour ne pas dire sa nostalgie c’est la Cité grecque, la citoyenneté antique, celle des … Continuer la lecture de Pour Hannah Arendt, la politique fait exister l’agir en commun →
Un lit pour la nuit L’humanitaire en crise, par Rackley Edward
Sur David Rieff : “A Bed for the Night. Humanitarianism in Crisis” , New York, Simon & Schuster, 2002 S’il y a un profane digne du nom de « compagnon de route » du mouvement humanitaire c’est bien David Rieff, avec son esprit critique et son éthique de l’action, et il l’est devenu pour beaucoup … Continuer la lecture de Un lit pour la nuit L’humanitaire en crise →
Des biotechnologies au biopouvoir, de la bioéthique aux biopolitiques, par Keck Frederic
Cet article propose une réflexion sur la notion de biopouvoir à partir de l’ouvrage de Paul Rabinow, ” Le déchiffrage du génome. ” Cet ouvrage propose en effet une analyse des rapports entre biotechnologies et bioéthique en France à partir de la notion de biopouvoir élaborée par Foucault. On peut retenir de cette articulation deux … Continuer la lecture de Des biotechnologies au biopouvoir, de la bioéthique aux biopolitiques →
Autoenquêtes en Italie, par Collectif des 116
Et toi, quel est ton genre ? Les Betty, intellectuelles précaires, partageant un désir militant, critiques tant vis-à-vis des groupes féministes historiques, que des pratiques politiques au sein du mouvement des mouvements, nous racontent leur création d’un espace, le “sexishock” au cœur même d’un centre social à Bologne. (version originale : art1191) —- Notre jeu … Continuer la lecture de Autoenquêtes en Italie →
Les angles morts, par Marange Valérie
La question de la violence est l’horizon de la dégradation de la politique en police, qui touche aujourd’hui au plus intime, pour faire pièce à un péril symbolique qui concernerait langage lui-même. Mais si ce langage de la culture court bien un risque, aujourd’hui, c’est celui de la vacuité, que semble avouer le mot d’ordre … Continuer la lecture de Les angles morts →
La politique comme guerre : formule pour une démocratie radicale ?, par Vatter Miguel
Depuis le commencement, le libéralisme s’est pensé lui-même comme étant en guerre avec « la guerre ». La guerre étant considérée comme la pire menace pour la société civile dont le but essentiel est l’autonomie des individus. Le libéralisme identifie deux sources principales de la « guerre » : d’une part l’orthodoxie, d’autre part la … Continuer la lecture de La politique comme guerre : formule pour une démocratie radicale ? →
Sur quelques vides ontologiques, par Ichida Yoshihiko
L’ontologie de Toni Negri, comme philosophie politique de la multitude, suppose un rapport très particulier entre philosophie et politique, déterminé par la non-différence des deux, tout en refusant de les faire dériver l’une de l’autre, ou de les médiatiser et de les faire fusionner par une tierce nécessité. Elles ne s’unissent là que par l’univocité … Continuer la lecture de Sur quelques vides ontologiques →
Politics as war : a formula for radical democracy ?, par Vatter Miguel
Version originale de art35, rub12 1. Introduction Since its inception, liberalism has thought of itself as being at war with “war.” It has understood “war” as the greatest threat to a civil society whose essential end is the autonomy of individuals, which in turn results in the development of “culture” and a “civilized world.” From … Continuer la lecture de Politics as war : a formula for radical democracy ? →
De l’éthique à la politique : l’institution d’une cité libre, par Auray Nicolas
L’intérêt parle toutes sortes de langues, écrit La Rochefoucauld, et joue toutes sortes de personnages, même celui de désintéressé. On pourrait en dire autant du travail : dans cette sorte de symphonie des supplices qui remplit notre vieille planète, il affiche toutes sortes de masques, dans un carnaval à plusieurs milliards de dollars. L’ingénieur passionné … Continuer la lecture de De l’éthique à la politique : l’institution d’une cité libre →
Politiques de la mémoire, par Cassin Barbara
Des traitements de la haineComment éviter que la lumière sur les faits et les actes passés ne fasse imploser toute communauté qui tente une refondation ? Le traitement de la haine, qui accompagne la guerre civile, est l’un des problèmes conjoncturels les plus aigus en politique L’article porte sur deux procédures d’exception : à Athènes, … Continuer la lecture de Politiques de la mémoire →
Mondialité, politiques de l’identité et citoyenneté, par Elbaz Mikhaël
On examine le concept de multiculturalisme pour en dégager deux lectures universalistes. La première : en dépit de nos différences, nous sommes tous humains, la seconde : grâce à nos différences nous accédons à l’humanité. À l’âge de la mondialisation, ce débat ouvre sur les enjeux de la crise de la citoyenneté et la ré-humanisation … Continuer la lecture de Mondialité, politiques de l’identité et citoyenneté →
Humanitaire et pouvoir au Kosovo, par Dachy Eric
Qu’il nous soit permis de saluer ici l’article de Mariella Pandolfi paru dans le n° 3 de Multitudes, et d’accueillir cette critique anthropologique de l’humanitaire comme une observation salutaire et d’une grande pertinence. Que nous dit Mariella Pandolfi ? Qu’elle a circulé parmi les réfugiés en Albanie, qu’elle les a accompagnés dans leur retour au … Continuer la lecture de Humanitaire et pouvoir au Kosovo →
L’Europe comme enjeu politique, par Wagner Peter
Le débat intellectuel actuel est marqué par l’absence de toute tentative pour penser politiquement l’Europe. La pensée critique se divise entre un conservatisme social-démocrate, centré sur la défense de l’État-nation, et une critique de la mondialisation désormais privé de forme politique. L’Europe est pourtant bien la forme nécessaire d’organisation politique du moment, et justement celle … Continuer la lecture de L’Europe comme enjeu politique →
Biopolitique ou politique ?, par Rancière Jacques
Entretien recueilli par Eric Alliez MULTITUDES – Dans votre livre, La mésentente, vous mettez à l’épreuve le questionnement politique en le confrontant à la fausse opposition sur laquelle il prend appui, dans La politique d’Aristote : la dualité de la voix (phônè), comme expression de l’utile, et de la parole (logos) comme expression du juste, … Continuer la lecture de Biopolitique ou politique ? →